Replacer dans le temps long ce qu’on pourrait prendre pour des préoccupations contemporaines, c’est l’enjeu et l’intérêt du travail d’historienne d’Aurore Évain, qui a notamment participé à la réhabilitation du terme d’autrice, parfois considéré à tort comme un néologisme. Entretien réalisé par Hakima El Kaddioui sur l’égalité de genre, dans et par le langage.
Comment répondre aux personnes qui estiment que l’égalité de genre peut se passer d’une lutte pour l’égalité de genre dans et par le langage ?
La démasculinisation de la langue est un combat politique qui n’a rien d’anodin. Les violences symboliques n’ont rien d’anecdotique. C’est bien parce que la langue est un puissant vecteur idéologique, un outil de légitimation ou de délégitimation, pour dire ou cacher le monde, qu’elle a été utilisée depuis des siècles afin d’empêcher les femmes de se sentir bien dans leurs mots, comme on se sent bien dans sa peau… pour paraphraser Benoîte Groult. Une femme qui peut légitimement se nommer au féminin dans son métier ou sa fonction se sentira moins empêchée lorsqu’elle aura à négocier son salaire, une promotion. Et le fait que, depuis l’époque latine, des grammairiens et académiciens aient passé autant de temps et d’énergie à masculiniser la langue prouve, en soi, que l’enjeu est de taille. La requête des dames à l’Assemblée nationale, sur laquelle je reviendrai, exprime clairement que la revendication symbolique doit être incluse dans la revendication politique. À leur suite, les féministes de la fin du XIXe et début du XXe siècle ne s’y trompèrent pas. Elles n’opposaient ni ne hiérarchisaient les combats : elles militaient pour le droit de vote, la féminisation de la langue, l’égalité des salaires, la contraception, le droit de porter un pantalon et de s’habiller comme elles l’entendaient, parce que… encore une fois, tout est lié. Hubertine Auclert, qui fut une militante féministe majeure, le résume très bien, lorsqu’elle déclare en 1898 : « L’omission du féminin dans le dictionnaire contribue, plus qu’on ne croit, à l’omission du féminin dans le code des droits) ».
L’Académie française vient tout juste de reconnaître la « féminisation des noms de métiers », pour reprendre la formule de plusieurs articles à ce sujet. Quels liens existe-t-il entre cette institution et le genre du langage en usage en France ?
L’Académie française est à l’origine de la masculinisation de la langue. Elle a élagué de nombreux féminins qui existaient au moins depuis le Moyen Âge (comme « autrice », « écrivaine ») et remplacé l’accord de proximité par l’accord au masculin, sous prétexte que celui-ci « est le genre le plus noble ».
Créée en 1635 par le cardinal Richelieu afin de « donner des règles certaines à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences », elle est un instrument pour institutionnaliser la langue et la culture, et les mettre au service d’un État-nation centralisateur. En légiférant le langage, l’écriture, elle va servir une idéologie absolutiste et… sexiste. Unité de langue, de temps, d’action, de lieu, de genre : tout est lié. Il s’agit d’ériger une pensée absolutiste centrée autour du corps du roi-nation, en empêchant la représentation symbolique d’une pluralité de pensées, de langues, d’orthographes, d’identités… Jusque dans les mots et leurs accords ne doit plus dominer qu’un seul genre grammatical : le masculin. La loi salique s’invite donc dans le langage : le masculin doit l’emporter sur le féminin. Sur le modèle de la chasse aux sorcières, la chasse aux féminins ou leur mise sous tutelle va donc se poursuivre dans le langage. Les membres de cette nouvelle Académie non mixte y trouvent en outre un intérêt personnel : le développement de l’éducation féminine, le fait que des femmes de la petite et moyenne bourgeoisie se mêlent d’écrire et de gagner leur vie avec leurs oeuvres, le succès que certaines rencontrent, telle Madeleine de Scudéry, qui produisit les plus grands « best-sellers » du XVIIe siècle, font de ces autrices, savantes et lettrées de redoutables concurrentes, à une époque où l’on assiste à la professionnalisation du métier d’écrivain.

Quand vont paraître les premiers dictionnaires de français à la fin du XVIIe, plusieurs féminins vont ainsi disparaître, dont le fameux « autrice ». Les grammaires vont entériner l’accord unique au masculin, ce qui ne va pas aller sans difficultés, y compris pour les tenants de la masculinisation de la langue, puisque cela va à l’encontre de l’usage et des habitudes euphoniques. Il y a donc bien eu intervention sur la langue et dressage des esprits, même si les femmes mettront plus de temps à s’y plier, s’opposant, comme Mme de Sévigné, à la disparition du « je la suis ». Mais l’Académie contrôlant désormais les outils de transmission et d’apprentissage (via les dictionnaires et grammaires), au XVIIIe siècle, le travail est déjà achevé. Si des voix continuent de réclamer l’usage de certains féminins, notamment à la veille de la Révolution française – au nom d’une langue plus égalitaire et en opposition avec une Académie française qui symbolise le pouvoir de l’élite –, la mémoire de la langue est perdue : ils sont revendiqués en tant que néologismes, et cette demande perd donc en légitimité. Pour autant, la résistance perdure, car beaucoup ont conscience que ce langage exprime une domination politique, comme l’illustre la requête des dames à l’Assemblée nationale en 1792 : « Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. »
Au XIXe siècle, avec le développement de l’accès à l’écriture et à la lecture, puis l’instauration de l’instruction obligatoire et gratuite en 1882, c’est désormais toute la population qui apprend et reproduit les règles sexistes édictées par l’Académie deux siècles plus tôt, ce qui donnera naissance au fameux « le masculin l’emporte sur le féminin », que des générations d’élèves répéteront en classe jusqu’à nos jours. Mais c’est au même moment que les féministes dites de la première vague vont à nouveau interpeller l’Académie française sur la féminisation des noms de métier, notamment la romancière Marie-Louise Gagneur en 1891. À la fin du XXe siècle, le débat revient dans l’agenda politique : les mentalités ont évolué, les femmes ont obtenu leurs droits politiques, l’Académie ne peut plus tenir les arguments qu’elle défendait depuis sa création. C’est alors qu’elle sort de son chapeau la différenciation entre métier et fonction, l’absence de rapport entre genre et sexe y compris concernant les êtres animés, et le principe d’un masculin générique, dit « universel ». Les attaques souvent violentes de certains académiciens (je pense ici aux propos de Georges Dumézil, linguiste et historien, pour qui seul le féminin « conne » trouvait grâce à ses yeux en 1984) contre les préconisations de la commission chargée de « féminiser » la langue vont aboutir à une solution de compromis : on prendra modèle sur le Québec en optant pour l’ajout d’un « e » discret et inaudible aux mots dont les féminins ont été supprimés par l’Académie trois siècles plus tôt. Quant à l’institution, elle continuera de faire preuve d’amnésie, en affirmant par exemple que le féminin « autrice » est un néologisme, et en s’érigeant contre toute interventionnisme dans la langue. Après avoir refusé de répondre aux féministes du XIXe siècle qui réclamaient la féminisation au nom d’une langue fonctionnelle, il faudra donc attendre les années 2010 pour que l’Académie française, cernée par les nouvelles recherches sur l’histoire de la langue, reconnaisse l’existence de ces féminins.
Pour résumer, on peut donc considérer quatre étapes clés :
-
- Au XVIIe siècle, l’Académie française est créée et entame la masculinisation de la langue, par l’effacement de féminins souvent liés à une activité prestigieuse, et par la mise en place de règles d’accord au masculin.
-
- À la fin du XIXe siècle, l’Académie est interpellée par des féministes qui réclament la féminisation au nom d’une langue fonctionnelle : elle rejette la demande car ces féminins pourraient légitimer les femmes dans des métiers et fonctions auxquelles elles ne devraient pas prétendre.
-
- Fin XXe siècle, l’Académie continue de s’opposer à la féminisation mais doit polir ses arguments et moderniser son discours, pour être en phase avec les idéaux égalitaires des démocraties post-68.
- En 2019, l’Académie, poussée dans ses retranchements par plusieurs études mettant en lumière les processus de masculinisation de la langue au cours de l’Histoire et par l’écho qu’elles reçoivent, accepte de reconnaître du bout des lèvres des formes féminines qu’elle rangeait auparavant parmi les néologismes. Elle continue cependant de pratiquer la désinformation, puisqu’elle évoque la « durée de vie encore plus courte » d’ « autrice », « du XVIe au XIXe siècle », alors que ce terme existe depuis l’Antiquité, qu’il n’a jamais disparu de l’usage, et qu’il fait un retour en force depuis cinq ans. Mais, au final, elle se résout à la féminisation des noms de métier, et 128 ans après, répond favorablement à la demande de Marie-Louise Gagneur.
Les difficultés, résistances et obstacles que nous connaissons en métropole face à la féminisation de certains termes ou l’usage de l’écriture inclusive se retrouvent-elles dans l’ensemble de la francophonie ? Sous les mêmes formes ?
La France, de par son histoire évoquée plus haut, est sans doute le pays où l’on a le plus résisté. Le mot « autrice » par exemple, a continué d’être employé en Afrique francophone et en Suisse, même si, pour cette dernière, des résistances demeurent : ce féminin a été dénigré et la réappropriation de ce terme pose problème à certain·e·s. Il n’en demeure pas moins que l’AdS, l’équivalente de notre SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), est l’abréviation de « Autorinnen und Autoren der Schweiz / Autrices et auteurs de Suisse / Autrici ed Autori della Svizzera / Auturas ed Auturs da la Svizra » ! La preuve de cet usage répandu d’ « autrice » dans la francophonie s’illustre par son entrée dans l’ODS (L’Officiel du jeu Scrabble) dès 2004. En Belgique, le quotidien Le Soir a débuté l’année 2019 en annonçant « sa bonne résolution » d’opter pour « autrice ».
De même, le Québec, qui a été pionnier dans cette réflexion sur le langage mais qui a privilégié la forme féminine en « eure », débat vivement aujourd’hui au sujet des accords et du féminin « autrice ». Les pro-« autrice » protestent contre la forme syntaxiquement incorrecte d’ « auteure », contre l’invisibilisation qui s’opère par l’ajout de cette lettre muette… Tandis que, dans l’autre camp, on s’offusque de ce nouveau colonialisme français qui voudrait imposer « autrice » ! Depuis ces cinq dernières années, c’est la connaissance de l’histoire de la langue qui a permis de relancer le débat en affirmant, preuve à l’appui, l’instrumentalisation politique de la langue depuis le XVIIe siècle. Il est devenu en effet paradoxal pour des démocraties modernes de défendre, enseigner et transmettre une langue obéissant à des règles d’accord sexistes, datant d’un autre âge.
Certain·e·s militant·e·s des communautés LGBTQIA estiment que la féminisation de la langue française en accentue également la binarité de genre : partagez-vous cette analyse?
Si l’on croit, à tort, qu’il s’agit de féminiser, on peut en effet considérer la question de ce point de vue. Mais si l’on prend conscience qu’il s’agit en fait de démasculiniser, alors, au contraire, on atténue cette binarité inhérente aux langues romanes. C’est la survalorisation du masculin dans la langue qui a survisibilisé le lien entre genre grammatical et sexe. Le fait que l’on puisse retrouver un usage non sexiste de la langue, où le masculin ne domine plus, permettra de rendre cette binarité moins prégnante.
Une fois cette étape passée, je ne suis pas opposée à une nouvelle intervention sur la langue, comme aux premiers temps de l’Académie ! Au nom cette fois d’une pensée égalitaire, à condition de ne pas l’imposer, mais de convaincre. Il faudrait déjà pouvoir réclamer plus de liberté dans l’usage de cette binarité structurelle à notre langue : pouvoir choisir son genre grammatical, indépendamment de son sexe, par exemple. Quant aux solutions à expérimenter pour trouver ce fameux neutre en français, elles me semblent, en l’état actuel, utopiques… et donc souhaitables, pour faire progresser nos représentations du monde. Dans le contexte d’une langue surgenrée, où l’usage du genre grammatical sert la domination masculine, les expérimentations pour indéterminer le genre sont les bienvenues. Mais peut-on faire totalement l’économie de la différence de genre ? J’en doute. En revanche, il est pertinent de lui donner moins d’importance. D’où mon engagement pour la démasculinisation de la langue, et non sa féminisation…
Vous êtes historienne, mais aussi autrice et metteuse en scène : identifiez-vous des liens entre le travestissement et le jeu de personnages inhérent au théâtre et ce(ux) qui se joue dans le langage courant ?
Le cas du mot « actrice » est éclairant à ce sujet. Jusqu’au XVIe siècle, les rôles de femmes sont tenus par des hommes travestis. En quelque sorte, l’acteur dans l’espace théâtral était générique : il pouvait inclure les personnages masculin et féminin. Et l’on ne trouvait pas de trace du féminin « actrice » dans les lexiques latin-français de l’époque. Le sens sémantique d’ « acteur » était par ailleurs très large : il pouvait même signifier « auteur ». Au XVIIe siècle, quand les actrices firent leur entrée en scène, le mot « actrice » apparut tout naturellement, et fut aussitôt inclus dans les premiers dictionnaires de français. Mais le mot « acteur » perdit sa richesse sémantique : apparut « actrice » quand le terme « acteur » se limita au sens de comédien. À l’inverse, le mot « autrice » disparut quand « auteur » – qui signifiait jusqu’à présent « augmenteur », « accroisseur » – se dota d’un prestige social et que s’institutionnalisa la fonction-auteur.
Le croisement au XVIIe siècle entre les féminins français « autrice » et « actrice » s’opéra donc à une période clé de l’histoire de la langue, mais aussi du théâtre et de nos représentations esthétiques. Quand l’acteur perd son pouvoir de représenter les deux sexes sur scène, le mot « acteur » se réduit au sens de comédien et, contrairement à « auteur », ne se généricise pas. Les codes esthétiques se transforment vers un naturalisme qui ira croissant. Les acteurs prennent en charge le masculin et les actrices le féminin. Mais, en parallèle, ces nouvelles actrices ne peuvent pas ambitionner d’être nommées « autrices », le terme faisant l’objet d’attaques et étant sorti des dictionnaires : l’impossibilité d’être désignées à cette fonction pour ces comédiennes – qui sont aussi, on l’oublie trop souvent, des femmes lettrées, sachant lire, écrire, sublimer…–, va ainsi influer sur leur place et leur image dans nos sociétés. Ce qui n’est pas nommé ne peut pas être représenté. L’éradication du terme « autrice » par les grammairiens de l’époque va par conséquent circonscrire également l’intervention des comédiennes dans la création. Elles peuvent être « actrices » pour dire les mots d’un « auteur », qui ne peut plus être nommé au féminin. De façon grossière, on peut dire qu’elles sont au mieux réduites à des porte-paroles au pire à des perroquets d’un créateur masculin… Tandis que l’acteur-auteur, tel Molière, pourra poursuivre ses va-et-vient entre le jeu et l’écriture. La répartition des rôles sur la scène et dans la création est, à travers les jeux de langage, clairement établie : apparaît « actrice » quand disparaît « autrice », entérinant l’image de la créature au détriment de la créatrice.
I. La loi salique désigne l’appareil législatif mis en place en France puis dans d’autres monarchies européennes pour exclure les femmes de la succession au trône.
II. L’euphonie désigne une agréable et harmonieuse combinaison de sons.
III. Lesbienne, gay, bisexuel·le, transgenre/transsexuel·le, queer, intersexe, asexuel·le.
Un entretien réalisé par Hakima El Kaddioui


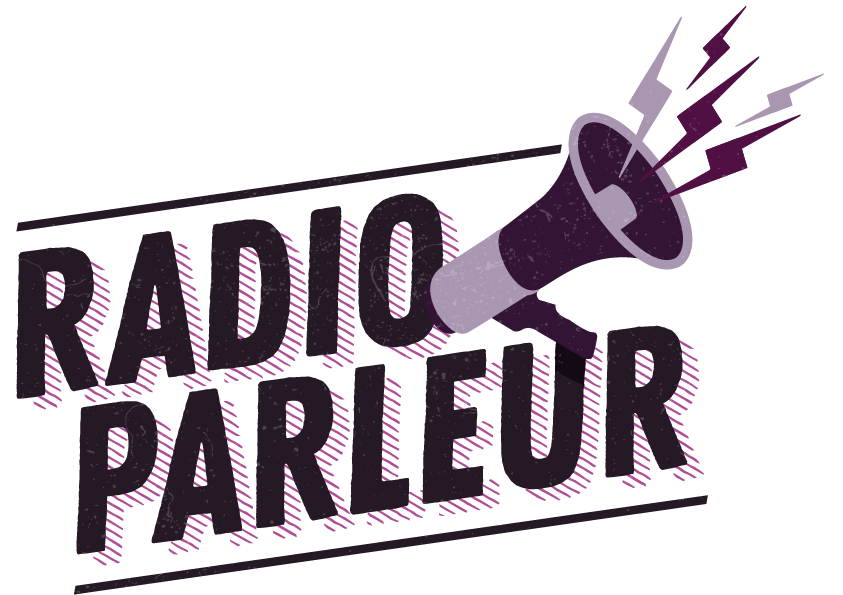


Cette lecture est proposée dans le cadre du partenariat de Radio Parleur avec la revue Mâtin. Chromatique, bâtarde et sans collier, Mâtin est une revue papier où textes, sons et images se répondent, brouillant les lignes entre politiques, arts et sciences. Un seul mot d’ordre : celui de la couleur de chaque numéro, et un même état d’esprit : le recul critique, parfois virulent, parfois grinçant, souvent (en)caustique . Mâtin paraît deux fois par an et elle est disponible en librairies. Woof !