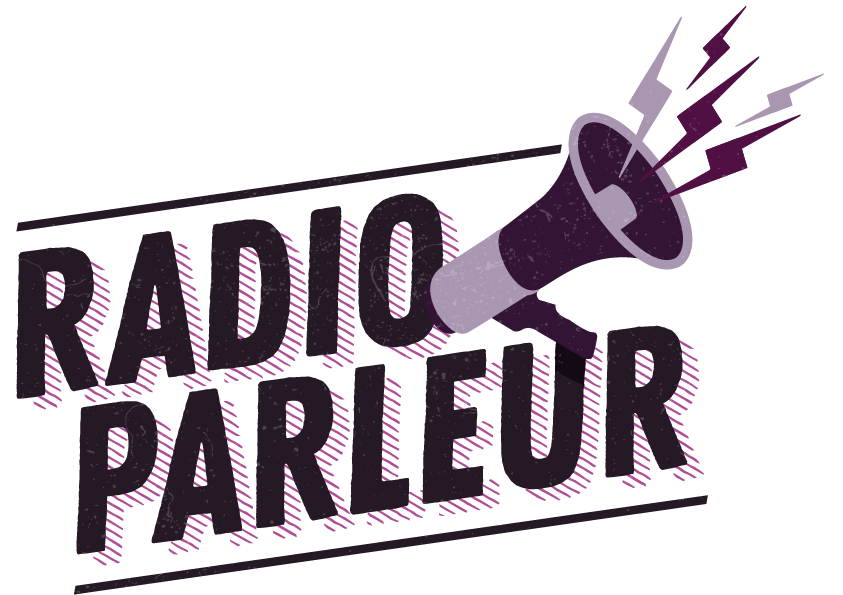Jusqu’au 19 janvier, le théâtre de L’échangeur, à Bagnolet, accueille LaMeute. Un collectif de photo-journalistes indépendant.es et engagé.es. En 12 images, ils.elles exposent le visage des luttes et des violences policières. Entretien avec Tuff* et Graine*, deux membres du collectif.
« Est-ce que vraiment cette photo valait le coup que tu te fasses défoncer pour ça ? » C’est la question que se pose Tuff, l’un des membres du collectif LaMeute. Le 3 avril 2018, un CRS « lui a fracassé le crâne » alors qu’il couvrait une manifestation de cheminots contre le projet de loi « pour un nouveau pacte ferroviaire ».
Le 8 décembre, c’est l’acte IV du mouvement Gilets Jaunes. Une journée marquée par des tirs de lanceurs de balles de défense sur plusieurs journalistes. Vingt-quatre d’entre eux porteront plainte contre la police pour des faits allant du tir de LBD à du matériel détruit ou confisqué abusivement. C’est le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner lui-même qui les a incités à porter plainte, en assurant « qu’aucune consigne n’a été adressée aux forces de l’ordre qui aurait eu pour effet de limiter l’exercice de la liberté de la presse ».

« Le premier acte de répression c’est d’empêcher les journalistes de montrer ce qu’il se passe »
Ce collectif a une signature, il pratique une photographie actrice. Ses membres ont par ailleurs publié un manifeste “Plaidoyer pour une photographie sociale” pour expliquer les positions et la pratique du collectif. Ainsi, ils et elles ne sont pas au devant ou en retrait mais dans le mouvement. Surtout, « toujours du côté des manifestants ». Alors, la violence, ils et elles se la prennent en pleine face. « On rassemble son courage à deux mains et on y va parce qu’il y a des choses à montrer », sourit Graine. Malgré la répression de plus en plus violente : le dernier bilan réalisé par le site de fact-cheking du journal Libération : Check News évoque 1700 blessés et plus de 500 arrestations. Graine est photo-journaliste au sein du collectif LaMeute. Il est clair pour lui que « la répression qui s’exerce sur nous est dépendante de celle qui s’exerce sur les manifestants ».
LaMeute continue de faire son travail, donner à voir et informer « parce que si on cède sur une liberté, autant céder sur toutes ». Mais les difficultés, les représailles, les risques pris dans l’exercice du métier ne sont pas nouveaux. D’après Graine, ils vont de pair avec la mise en place de l’état d’urgence après les attentats de Paris en 2015. « On est dans un moment de l’histoire où il y a un retour du sécuritaire et avec l’entrée dans le droit commun des mesures phares de l’état d’urgence, on voit que le droit en France c’est malléable. Surtout quand on regarde, un policier condamné c’est rare ou alors c’est du sursis. Et le premier acte de répression, c’est d’empêcher les journalistes de montrer ce qu’il se passe ».
Ce travail au plus près des violences n’est pas sans conséquence pour ces photographes. Le 3 avril 2018, Tuff s’est fait ouvrir la tête sur plusieurs centimètres par un policier armé d’un tonfa, « une matraque flexible qui a limité les dégâts ». Il explique que depuis « ce traumatisme » il a choisi de modifier sa manière de travailler pour « se réparer ». Il prend plus de recul et tente de capter avec son appareil cette violence qui inonde la ville lors des journées de tensions sociales.

Les caractères de la violence
La violence montrée en image par LaMeute n’est pas représentée que par des corps en mouvement, en lutte, elle l’est aussi par le vide qui lui succède. Une photographie montre un paysage où les nuages se confondent avec le brouillard des bombes lacrymogènes. Sur une autre image, c’est une place touristique vidée de son animation. Une violence qui a plusieurs visages, celui de ceux qui la subissent, de ceux qui l’infligent et de ceux que l’on fait taire. Se rendre à l’exposition, regarder, scruter les photos de LaMeute c’est prendre un parti pris. Pour le collectif, la neutralité journalistique n’a pas de raison d’être : « si on a une chose a montrer c’est ce que cette répression inflige à notre camp social, ce qu’elle inflige dans nos chairs, à notre moral et c’est cela qui transpire dans nos photos ». Leur travail fait écho à celui d’artistes comme Kader Attia, la mémoire des blessures, de l’humiliation, de l’oppression appartient à un corps social. Il s’agit de la montrer pour participer à la réparer et donner à voir le fil rouge de l’histoire pour ceux qui persistent à l’ignorer.
Un entretien réalisé par Scarlett Bain. Tuff* et Graine* sont leurs noms de photographes utilisés pour travailler au sein du collectif.