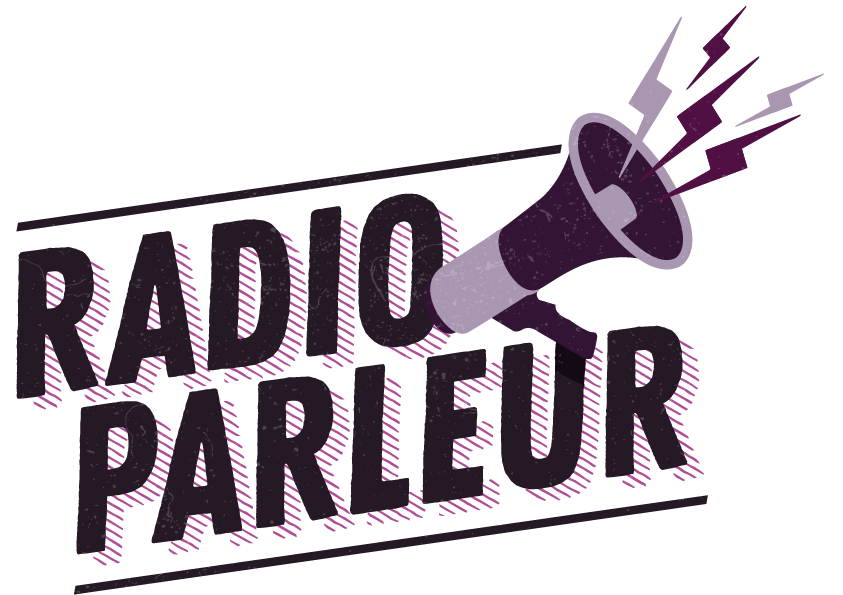Virée pour un simple café froid jeté à la figure d’un militant d’extrême-droite, Ana* tente de récupérer son emploi. Cette doctorante et chargée de cours à l’université ParisVII-Diderot a appris la rupture de son contrat le 25 septembre 2018 pour une simple mention sur son casier judiciaire. Elle et ses soutiens dénoncent une “répression militante”.
Après un master en sociologie et genre, Ana obtient une allocation de recherche avec charge d’enseignement pour poursuivre une recherche de thèse. Elle signe en septembre 2018 avec l’université Paris VII et commence à enseigner. À peine un mois plus tard, la DRH la convoque par mail en refusant de lui en donner le motif. Ana se rend donc à cette convocation, seule. « J’arrive sans avoir connaissance de mes droits et on me dit : ‘On va rompre votre contrat parce qu’il y a une mention dans votre casier judiciaire’ », explique-t-elle. Or une mention judiciaire n’implique pas l’interdiction de travailler dans une institution publique. Cela relève d’un choix de la présidence. Ana n’y comprend rien, tant les faits sont insignifiants.
“Mon arme, c’était du café froid”
Dans le casier judiciaire de la doctorante, on peut lire : “violence avec arme par destination”. Retour en 2014, Ana étudie en licence dans une université du Sud de la France. Elle tient une table d’information, pendant des élections syndicales et associatives particulièrement tendues. Elle évoque des “insultes sexistes, antisémites, homophobes et racistes” à répétition de la part de militant·es d’extrême droite. Le premier jour, Ana et ses camarades arrivent à les repousser jusqu’au tramway. La fac prévient alors qu’elle ne veut plus de conflit sous peine d’annuler les élections. Les syndiqué·es décident donc de ne plus répondre aux provocations.
Le jour suivant, les fascistes reviennent. Alors que le mot d’ordre est de les ignorer, ils vont avoir un geste impardonnable pour Ana. “Une camarade était en train de coller une affiche quand un mec des jeunesses du Front National l’a poussée. Là, c’est de la violence physique, on devait réagir.” À ce moment, elle saisit d’un gobelet posé sur la table et jette un reste de café froid sur les militant·es d’extrême-droite. Vue par des caméras de surveillance, ce geste lui vaudra un procès de la l’Université. Condamnée à 315 euros d’amende, son casier judiciaire en comporte la mention. “Je devais être assez mal défendue à l’époque pour ne pas avoir de “non inscription au casier judiciaire” alors que j’avais un casier vierge” , déplore-t-elle. D’après elle, la charge de “violence avec arme par destination” est courante dans les procès de militants. En l’occurence… du café froid.

Une administration sourde
Cinq ans plus tard, alors que cette condamnation la rattrape, elle fait tout pour clarifier la situation auprès de son employeur. Comprenant que la mention dans son casier puisse interroger, elle fournit les pièces nécessaires pour prouver à la présidence le caractère bénin des faits qui lui sont reprochés. “J’ai écrit des lettres, fourni des documents pour montrer que c’était léger, et que je ne suis pas quelqu’un de dangereux.” Elle propose même, à contre cœur, de renoncer à sa charge d’enseignante pour se concentrer uniquement sur ses recherches. L’administration reste sourde et ne martèle qu’une chose : “on s’en fout du contenu, on ne prend personne avec un casier judiciaire”, rapporte Ana.
Cependant, l’Université elle-même ne semble pas croire à la dangerosité de la doctorante. L’administration lui promet de ne pas rompre son contrat si elle arrive à faire effacer son casier avant le 15 octobre. Les délais de ce type de démarches étant très longs, cette proposition ressemble pour Ana à une fin de non recevoir. Ensuite, Paris Diderot lui garantit la signature d’un nouveau contrat si elle parvient à faire effacer son casier avant septembre 2019. Elle peine à comprendre la raison de son licenciement alors qu’elle leur a fourni un papier prouvant que les démarches d’effacement sont en cours. “Je ne vois pas pourquoi ils veulent rompre mon contrat pour en re-signer un autre plus tard alors que c’est totalement légal de me garder”, déplore la jeune femme.
Cet excès de zèle ne semble pas inhabituel à Paris Diderot selon Ana, qui évoque le cas d’un doctorant en physique, Pierre*, qui a subit les mêmes pressions. Après différents stages en laboratoire, il allait signer un autre CDD et un contrat doctoral quand l’université a coupé court à toutes les démarches. La raison ? Une mention dans son casier renvoyant à la conduite d’un scooter sans permis en état d’ivresse à l’âge de 19 ans. Les choses se sont arrangées pour le doctorant “pour des questions économiques” d’après Ana. “Vu que le financement de Pierre ramenait de l’argent à l’université Paris Diderot, elle a reconsidéré sa décision”, explique-t-elle.
Étudiant·es et doctorant·es se mobilisent
Beaucoup d’étudiant・es et d’enseignant・es dénoncent une “répression militante”, et se mobilisent pour soutenir Ana. Plus de 450 universitaires dénoncent la rupture du contrat de la doctorante dans une tribune publiée sur Mediapart le 29 octobre 2018. Ils et elles y voient “une contribution à la répression croissante contre l’engagement étudiant dans les universités”. Un “comité de soutien à Ana” est créé et de nombreux rassemblements sont organisés sur l’esplanade de l’université Paris VII. Face à ces manifestations d’étudiant·es et de doctorant·es l’université fait fermer ses grilles et refuse toute forme de dialogue. Radio Parleur a tenté de contacter la présidence qui n’a pas répondu à nos sollicitations.
La lutte se place désormais sur le plan juridique. La doctorante a fait une demande d’annulation de la décision de l’Université au tribunal administratif. Soutenue par le juriste spécialiste en droit du travail Emmanuel Dockès, et par son avocat, elle est confiante, même si tout reste à faire. Une cagnotte a d’ailleurs été ouverte pour soutenir Ana dans ses démarches judiciaires longues et coûteuses.
* Les prénoms ont été modifiés