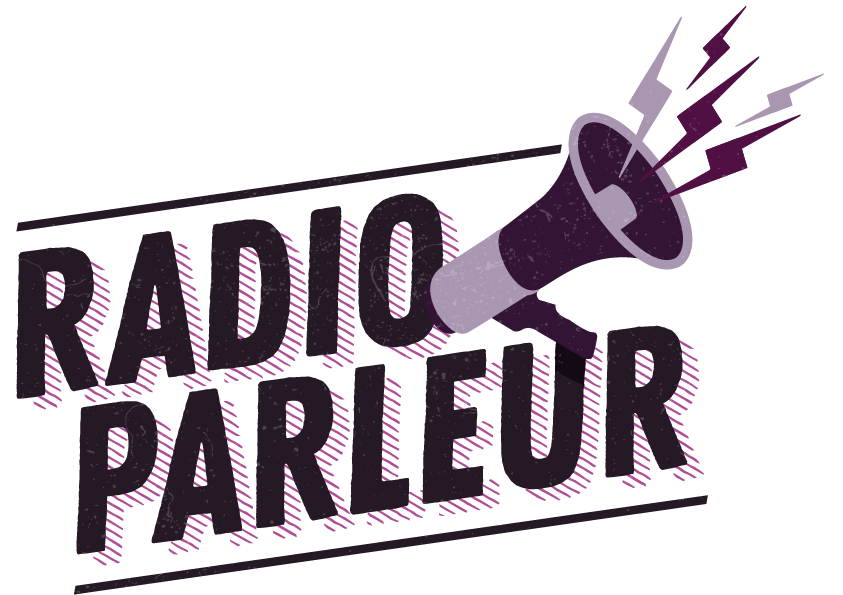Une étudiante sur 10 est victime d’agression sexuelle. Une étudiante sur 20 est victime de viol. Ces chiffres percutants ont été saisis par la réalisatrice Charlotte Espel dans son premier documentaire intitulé : Étudiantes en terrain miné. Ce film donne la parole à cinq étudiantes ou doctorantes victimes de harcèlement ou de viol qui se battent pour que les violences ne passent plus sous silence. Il suit aussi des associations qui tentent de briser l’omerta et porte un éclairage cru sur les dérives dans le monde de la recherche. Une projection suivie d’un débat est organisée à Césure à Paris, le samedi 12 octobre. Entretien avec Charlotte Espel.
Qu’est-ce qui vous a poussée à réaliser ce documentaire ?
Charlotte Espel : D’abord, je pense que c’est parce que j’ai un attrait pour la psyché humaine en général, pour les traumatismes, parce que ma mère est psy, donc nous avons de longues conversations à propos de ça. J’ai également été une victime lorsque j’étais étudiante en Erasmus. Pendant la vague #MeToo, je me suis demandée si des chiffres existent sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant, mais ce n’était absolument pas documenté. Pendant ces recherches, le premier rapport de l’Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur a été publié. Ces chiffres sont le point de départ du film. Une étudiante sur dix est victime d’agression. Une étudiante sur vingt est victime du viol. Je me dis que je ne suis clairement pas un cas isolé et que ce n’était pas un sujet traité. J’ai commencé à chercher les associations qui se positionnent sur le sujet, j’ai vu que la réponse des universités n’était clairement pas suffisante. Au début, je me suis circonscrite au cas des étudiantes. Puis, j’ai rencontré Adèle B. Combes qui a écrit un livre qui s’appelle Comment l’université broie les jeunes chercheurs. À partir de ce moment, je me suis rendu compte que chez les étudiantes, les agresseurs sont d’autres camarades et pour 90 % des victimes, l’agresseur est un de leurs proches et c’est souvent dans les premiers mois d’entrée à l’université. Chez les doctorantes, il y a plus de harcèlement moral et sexuel commis par les directeurs de thèse. J’ai finalement décidé de faire un film sur ces deux dimensions.
Comment avez-vous trouvé ces témoignages d’étudiantes et de doctorantes ?
Plusieurs associations féministes m’ont aidée et ont relayé mon appel à témoignage. Je pensais recevoir beaucoup de témoignages anonymes, mais au final j’étais surprise de recevoir des dizaines et dizaines de témoignages de femmes à visage découvert, qui à ce moment-là avaient besoin d’être écoutées et de libérer leur parole pour que d’autres victimes parlent aussi. J’ai reçu de nombreux témoignages d’étudiantes en médecine et j’ai parlé avec une quarantaine de femmes en tout. Je voulais représenter toutes les filières d’études pour montrer le côté systémique de ces violences. Les violences ne dépendent pas du niveau d’études. Aucun milieu n’est épargné. Je voulais aussi montrer les deux dimensions des violences à l’université. D’un côté, les étudiantes agressées par leurs camarades ou par des professeurs et de l’autre côté, les doctorantes agressées par leurs directeurs de thèses ou leurs professeurs. Je voulais également montrer qu’il y a des affaires qui stagnent complètement, d’autres qui mènent à des commissions disciplinaires au sein de la faculté et d’autres cas où les victimes n’ont jamais dénoncé leurs agresseurs. Seulement 10% des victimes portent plainte.
Le documentaire débute par des images de manifestations féministes et de colleuses et vous rappelez aussi les scandales de violences sexistes et sexuelles de “Sciences Porcs” et Centrale Supélec en 2021. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
Tout d’abord, pour introduire le contexte, dire qu’on va parler de quelque chose qui est dans l’air du temps pour mieux se lancer dans le film et accrocher le spectateur. Je voulais commencer par des images fortes de manifs pour dire aussi que la solution va venir de la sororité entre femmes. Souvent les victimes s’engagent dans des associations pour aider d’autres victimes. Selon moi, c’est vraiment l’entraide la solution qui permet petit à petit de faire entendre sa voix et crée un effet boule de neige. L’objectif était aussi de dire que ces étudiantes ne sont pas seulement victimes, mais qu’elles sont aussi des combattantes. Je ne voulais pas qu’elles aient une posture passive, mais montrer qu’elles sont dans l’action, dans la lutte et la résilience.
Vous suivez trois associations : Women Safe, le CLASCHES (collectif anti-sexiste de lutte contre la harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur) et l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur. Comment avez-vous imaginé la trame du documentaire, entre les témoignages et les associations ?
Cela s’est fait petit à petit, un peu par hasard. Au début, je voulais seulement suivre l’association Women Safe, qui a créé des partenariats avec des universités et fait office d’écoute externalisée pour les victimes. Mélissa Theuriau a sorti un documentaire sur le travail de l’association [N.D.L.R. qui s’intitule Réparer les vivants], en 2021, donc je ne voulais pas refaire le même. L’Observatoire des VSS dans l’enseignement supérieur est avancé sur cette problématique et fait de la prévention et de la sensibilisation. Le CLASCHES est plus avancé dans les commissions disciplinaires et les sanctions internes à l’université. Pour la trame, j’ai choisi d’alterner entre les moments de témoignages, le temps de parole plus lent et posé et les “séquences” avec les associations où on sort un peu plus de l’émotion. Je ne voulais pas qu’il y ait tous les témoignages d’un coup, car c’est très lourd à digérer. Je voulais un “temps de repos” en sortant du témoignage, et en étant plus dans l’association et après revenir sur le témoignage.
Est-ce que vous avez pu voir que le travail des associations a un impact sur les réponses des universités sur ce sujet ?
Oui, les facultés ne peuvent plus nier que les violences sexistes et sexuelles existent à l’université. Dans les faits, il n’y a pas assez de moyens mis en place. Les cellules d’écoutes sont souvent des cellules dormantes, je ne sais pas dans quelle proportion, mais elles ne répondent pas aux besoins des étudiant·es. Les personnels des cellules ne sont pas formés aux violences sexistes et sexuelles, c’est qui est très grave, car ils recueillent souvent en premier la parole des victimes, parfois même avant les psychologues. C’est un moment charnière pour les victimes qui peut être doublement traumatisant si leur parole n’est pas bien recueillie. La réponse des universités n’est clairement pas à la hauteur. Au niveau de l’écoute déjà, faute de moyens et de volonté de certains présidents d’universités. La sensibilisation sur les VSS est obligatoire dans toutes les facultés, mais certaines ne le font pas, ou alors les étudiant·es ne s’y intéressent pas. Dans certaines écoles, ils ont des modules obligatoires sur la prévention des VSS. Ensuite, la réponse n’est pas suffisante au niveau des sanctions. Il y a très peu de mesures préventives, les professeurs se protègent entre eux par corporatisme, les affaires sont étouffées. Quand un cas chemine vers le stade de la commission disciplinaire, où le professeur est inquiété, il fait souvent appel de la décision. Le Cneser, [N.R.D.L. Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche], l’instance qui surplombe toutes les universités de France, annule les sanctions. Les enquêtes ne sont pas faites correctement car il n’y a pas de juristes dans les commissions, iels jugent sur la forme et pas sur le fond. C’est donc la double peine pour les étudiantes. Elles doivent subir deux ans de procédure où elles répètent leurs témoignages, on leur demande des preuves et on remet leur parole en doute. Et même au bout de ce parcours de combattante, la sanction est annulée. Il y a une impunité totale.
Dans tous les témoignages, le sentiment de culpabilité revient comme un boulet au pied, comment percevez-vous cela ?
Personnellement, j’avais beaucoup de culpabilité en tant que victime. En parlant avec ces femmes, je me suis rendu compte que c’était quelque chose très présent et qui empêche de parler et dénoncer, c’est d’ailleurs pour ça que les victimes sont peu nombreuses à porter plainte. En tant que femme au sens social, on nous dit qu’on est responsable de ce qui nous arrive. On se sent sale lorsqu’on est harcelée, violée, agressée, et on se sent coupable. La sidération est aussi un phénomène que je n’avais pas bien compris avant de faire ce film. La psychologue de l’association Women Safe explique très bien cet état, et pour moi c’est presque la phrase du film qu’il faut retenir. Elle utilise l’expression d’un “lapin dans les phares d’une voiture”. La sidération c’est un état de survie qui s’explique par des phénomènes biologiques. Le stress chez la victime atteint le seuil de tolérance au niveau chimique, le cerveau arrête de produire le stress et produit de la kétamine et de la morphine. Comme si la victime était sous un anesthésiant puissant et ne pouvait plus bouger. Cet état de sidération augmente le sentiment de culpabilité : je ne me suis pas défendue, donc je suis coupable. Le travail de Women Safe commence par là. Il faut faire tomber la barrière de la culpabilité pour commencer un travail thérapeutique.
Dans le documentaire, les conséquences physiques et psychologiques sur les victimes et les incidences sur leurs études et leurs carrières sont bien révélées…
Oui, les répercussions sont concrètes et multiples sur la santé. Pour les cas de harcèlement aussi, c’est quasiment pire ou équivalent en terme de conséquence qu’un viol ou une agression. Les conséquences sont sur le long terme et importantes, car le harcèlement est prolongé dans le temps. La culpabilité est aussi encore plus forte, parce que les étudiantes se disent qu’elles auraient dû parler ou agir plus tôt.
Quelles sont vos attentes personnelles et professionnelles par rapport aux répercussions de votre film ?
J’aimerais que ce soit un objet de prévention et qu’il permette de créer un mouvement vertueux vers la libération de la parole. Briser l’omerta dans les universités et que d’autres victimes voient le film, se rendent compte qu’elles ne sont pas seules et dénoncent. Le problème des violences sexistes et sexuelles est l’impunité qu’il y a derrière. Avec mon équipe, nous avons fait une tournée de projection du film dans une vingtaine d’universités. J’espère aussi que les universités se rendent compte qu’elles ne font pas assez, tout comme le ministère de l’enseignement supérieur. À titre personnel, que ce soit pour moi ou pour les victimes, le film répare, et je n’avais pas imaginé cela. Je me sentais un peu mal de devoir leur faire répéter ces moments traumatisants, mais au final elles m’ont toutes remerciée. Être vraiment écoutées et reconnaître leur statut de victimes, ça leur a fait du bien. Ça m’a réparée aussi de me dire que je ne suis pas la seule dans ce cas.
Projection et débat à Césure (5e, Paris) à partir de 20 h dans l’amphi B. Gratuit sur inscription.
Clémence Le Maître