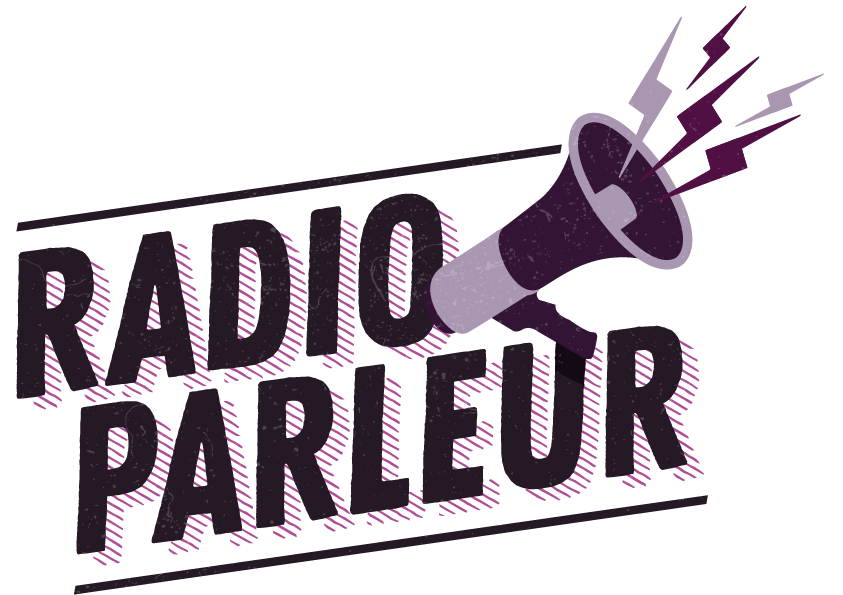Un an jour pour jour après le drame qui a embrasé les quartiers nantais, l’enquête sur la mort de Aboubakar Fofana se poursuit sous l’autorité d’un juge d’instruction. Les proches de la famille et les habitants du quartier du Breil restent quant à eux, toujours dans l’attente de la vérité. Entre la crainte de récupérations extérieures et les discussions avec les soutiens, ils poursuivent leur collecte de témoignages pour faire émerger leur version des faits.
Il est 17h lorsqu’un soleil de plomb frappe la rue des plantes. Nous sommes le samedi 7 juillet 2018, au cœur du quartier du Breil, situé au Nord de Nantes. Des personnes se regroupent devant le muret brisé du petit pavillon, au numéro 66. On y décerne encore, au milieu des fleurs et des mots d’hommage, des traces de sang. Celui d’Aboubakar, 22 ans, tué par balles au volant de son véhicule le mardi 3 juillet 2018, lors d’un contrôle d’identité par la police. Casquette à la main, cheveux frisés bruns et vêtu de noir, Sélim était un ami d’”Abou”, surnommé aussi « Le Loup » dans le quartier, en raison de son caractère solitaire. Seul, le garçon stationne ici, répondant aux interrogations des curieux venus se recueillir ou apporter du soutien. Près du muret, un trentenaire s’interroge : « Que s’est-il passé ? ». « Un meurtre » lui répond le jeune homme.
Si l’abattement et la colère se font d’abord sentir parmi la jeunesse du quartier du Breil, les langues se délient peu à peu pour rétablir la vérité des faits. Epuisé, Sélim répond au flot ininterrompu de questions des passants en se frottant les yeux, avant d’ajouter « je dors plus, je ne mange plus ». Aboubakar, c’était son ami, avec qui il jouait à se chambrer « à celui qui est le plus beau ». Comme pour preuve, il dégaine une vidéo de son smartphone sur laquelle Abou danse au son d’une musique zouk. Les traits du visage sont également tirés chez ceux qui incarnent les « grands Frères » du quartier. Regroupés le lendemain dans une rue adjacente, ils manifestent leur hésitation à s’adresser une énième fois à un média, avant de se plier, malgré tout, à l’exercice. Devant un square d’où s’échappent les cris des enfants qui jouent, les discussions vont bon train sur le bitume. A quelques mètres de là, au bout de l’allée, une poubelle flambe. La police ne va pas tarder.
« Il y a eu trop de faux discours. Nous sommes obligés de nous exprimer »
Entouré par plusieurs jeunes, Saïd En Nemer, un associatif du quartier veille sur le trottoir. Le trentenaire est le co-organisateur de la marche blanche organisée en l’honneur de Aboubakar Fofana le jeudi 5 juillet. Il est rapidement rejoint par Christian, un autre organisateur de la marche. Ce grand blond massif confie aussi sa difficulté à faire entendre une autre voix que celle qui domine dans les médias et la lassitude qui en découle : « On est fatigués de parler. Au début c’est la peine qui te fait parler mais au bout d’un moment t’en peux plus, il y a l’émotion qui remonte, c’est dur ». Une parole forcée, qui se fait toujours dans une grande méfiance.

Malgré le deuil, c’est la nécessaire réplique à un discours policier vacillant qui les a poussés à prendre la parole. Le Mercredi 4 juillet, l’auteur du tir assure, lors de sa première déposition, avoir ouvert le feu face à la menace que représentait le jeune homme au volant de sa voiture plaidant la légitime défense. Une version corroborée par un discours visant à criminaliser la victime, selon l’analyse de Michel Kokoreff, sociologue et professeur à l’université Paris VIII. « Au départ, c’était un délit de fuite caractérisé. Le discours est de dire que ce qui s’est passé est normal “car” c’est un délinquant. A l’évidence, divulguer le casier du jeune homme et insister sur les violences est une manière de masquer l’homicide. »
Lorsque l’on évoque le mandat d’arrêt retenu contre Aboubakar Fofana pour « vol en bande organisée, recel et organisation de malfaiteur », Saïd En Nemer s’emporte : « Mais quel est le rapport avec le fait qu’il ait été tué ? Pourquoi ne pas rétablir la peine de mort dans ce cas ? Nous sommes dans un état de droit. La justice n’est pas le far west ! »
Par la suite, la version policière évolue et fait chanceler les discours. L’auteur du coup de feu revient sur ses propos, avouant avoir tiré involontairement sur Aboubakar à la suite d’un corps-à-corps avec ce dernier, comme le précise le procureur de la République de Nantes, lors d’une conférence de presse le vendredi 6 juillet 2018. Une version qui reste encore à éclaircir pour Saïd, même si ce retournement lui apparait inédit : « c’est unique ! D’habitude personne n’avoue. Mais il y a encore des mensonges. D’après les témoignages que nous avons, il n’y a eu aucun corps à corps entre Abou et le policier. C’est flou cette histoire, on ne voit pas trop comment ça aurait pu se passer comme ça… »
« Je suis sûr que c’est parce qu’on a fait tout ça que le flic a flanché »
Pour Sélim, ce revirement spectaculaire a été possible par la mobilisation des habitants du quartier et des proches de la famille : « Je suis sûr que c’est parce qu’on a fait tout ça que le flic a flanché. Parce qu’on a fait la marche blanche, parce qu’on a communiqué, parce qu’il y a eu les émeutes ». Un avis partagé par les ainés du quartier qui, en quête de vérité et de justice, se sont organisés au lendemain de la mort du « Loup ».
Première étape : amasser des témoignages pour rétablir les faits. Saïd et Christian se relaient dans ce travail de collecte en parallèle de leurs emplois respectifs, dès qu’ils ont « 5 min de temps libre ». « Nous avons fait du porte-à-porte. Nous avons collecté des vidéos. Nous comptons tout donner aux avocats de la famille » intervient Saïd. Un travail qui apparaît nécessaire et non achevé pour Me Anna Bouillon et Me Franck Bouëzec. Les deux avocats de la famille ont lancé un appel à témoins le lundi 9 juillet afin de rappeler que seuls « six policiers et un témoin ont été entendu ».
Pour Saïd la difficulté de la tâche vient surtout de la réticence des témoins à « être mêlés à cette histoire et se retrouver face à la police ». Le trentenaire s’interrompt alors. Durant l’entretien, alors que des enfants s’éclaboussent dans la fontaine au centre du square, une brigade de policiers remonte l’allée, accompagnée des pompiers, pour éteindre la poubelle en feu. Chacun dégaine son téléphone pour filmer. Rien d’inhabituel pour tous les présents.
Dans cette affaire, l’image et les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant. Deux jours après le drame, des vidéos amateurs illustrant le contrôle de police paraissent sur Twitter et bientôt dans les médias. Un réflexe de saisir son téléphone qui devient un argument de poids dans ce dossier de bavure. « Avoir ces vidéos rapidement a joué dans le fait que le policier revienne sur sa version. J’essaie, personnellement de tout filmer, de partager sur les réseaux » confirme Saïd. C’est là qu’intervient la seconde étape : rendre hommage au mort et contrer les discours. Pour ces « Grands frères », c’est l’objectif de la marche blanche organisée le jeudi précédent et qui a réuni environ 1200 personnes au Breil. « La famille n’a pas de haine. Ils veulent que justice soit faite. Si justice est faite, cela permettra à la police de redorer son blason et montrer qu’elle peut être honnête. Honnête jusqu’au bout. » Dans le même temps, les habitants mobilisés insistent sur la tranquillité de leur quartier et sur le caractère jovial de Abou, un jeune homme « toujours prêt à rendre service à ceux qui en avaient besoin » indique Christian.
« A partir des années 90, un travail s’est opéré auprès des familles »
Michel Kokoreff y voit une forme de mécanisation dans la mise en œuvre de ces moyens d’actions, qui ne sont pas nouveaux. « Les membres du Mouvement de l’Immigration et des banlieues (MIB) connaissaient le scénario et ont donc apporté des conseils aux familles concernées. Ils s’organisaient, ils demandaient une contre-expertise. Pour le cas de Aboubakar, c’est plus flagrant. Ils se sont organisés pour former un contre-discours au sens de Foucault ». Pour ce chercheur, cette organisation venant enrichir le répertoire d’action pose également la « question de la légitimité des enquêteurs de police et de la transparence de l’enquête ». Si Saïd et Christian admettent volontiers suppléer au travail des enquêteurs, ils s’en remettent expressément à la justice pour trancher. « Nous croyons en nos institutions, en la justice pour rétablir la vérité. Nous ne sommes pas dans une stratégie de médiatisation, nous voulons que la justice soit rendue et là ça va plutôt dans le bon sens » renchérit Saïd.

La crainte de récupération politique
Bouna Traoré, Zyed Benna, Amine Bentounsi, Adama Traoré… Peut-on dessiner un schéma d’action commun face à des cas de violences policières ? Si des étapes similaires de lutte pour établir un contre-discours sont observables, les stratégies divergent parfois. Dimanche matin, alors qu’un petit groupe de discussion s’est formé au pied des tours du Breil, Taha Bouhafs, membre du collectif Vérité et Justice pour Adama s’avance. Ce militant s’est déplacé à Nantes pour incarner le soutien de son collectif et proposer des conseils, au besoin. Une solidarité dans la lutte qui apparaît primordiale à Youcef Brakni, porte-parole du comité Vérité et Justice pour Adama : « Nous sommes toujours prêts à apporter notre expérience, à expliquer comment s’organiser, comment créer un collectif, comment démonter les mensonges et répondre coups pour coups ».
Si Saïd et Christian acceptent volontiers leur soutien – qui s’ajoute à celui des zadistes, des autonomes, et de d’autres collectifs également venus sur place – ils rejettent cependant certains modes d’actions. Christian suggère qu’une forte exposition médiatique « pourrait nuire au fait que la justice soit rendue rapidement » et serait contraire au souhait de la famille. Le débat s’engage sur le trottoir. Pour Taha Bouhafs, au-delà de la quête de vérité pour un seul individu, il s’agit aussi d’un combat « pour tous les futurs Adama et contre une oppression plus globale envers les minorités ». Ces réticences des proches, Youcef Brakni les comprends également, mais la politisation de l’affaire lui parait nécessaire : « comme beaucoup de familles, c’est le traumatisme qui s’exprime. Ils en viennent à se dire que si on politise trop, ça va poser des problèmes. Notre travail c’est de les convaincre. Si vous ne politisez pas ces cas-là, si vous n’installez pas un rapport de force, vous pouvez toujours attendre ».
Cette méfiance dans la politisation du combat, Michel Kokoreff l’explique par la crainte d’être « dépossédé d’une action par des gens extérieurs, une forme de méfiance sur l’instrumentalisation politique de cet évènement même s’il y a convergence des luttes apparente ». Le rapport à l’institution judiciaire semble ambivalent dans ces différents cas de bavures. Le sociologue l’examine ainsi : « Il y a une foi et une légitimité accordée à l’institution, qui perdure encore bien que, par ailleurs, l’institution soit très critiquée, délégitimée, accusée d’être raciste. Les collectifs qui se forment, au début de leur démarche, n’ont d’ailleurs pas tellement de solutions : ils doivent recourir à la justice ».