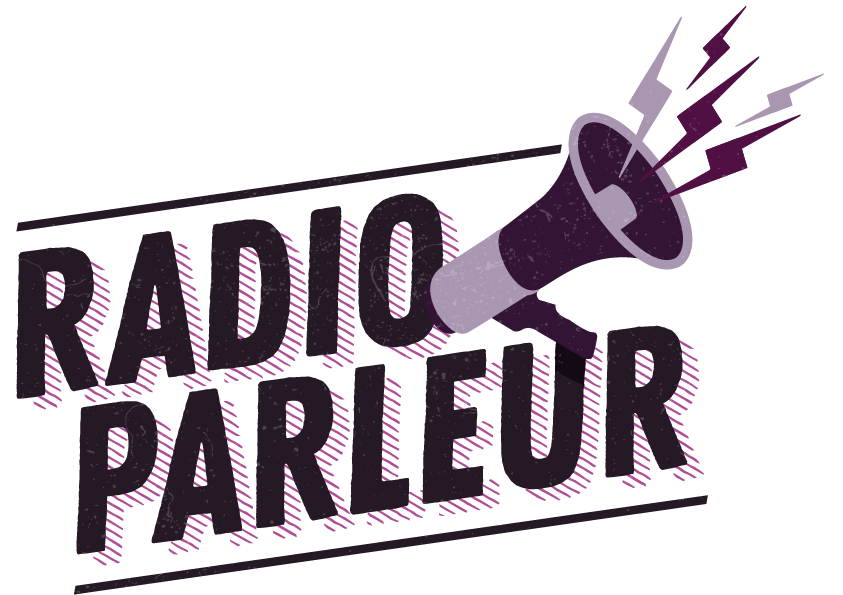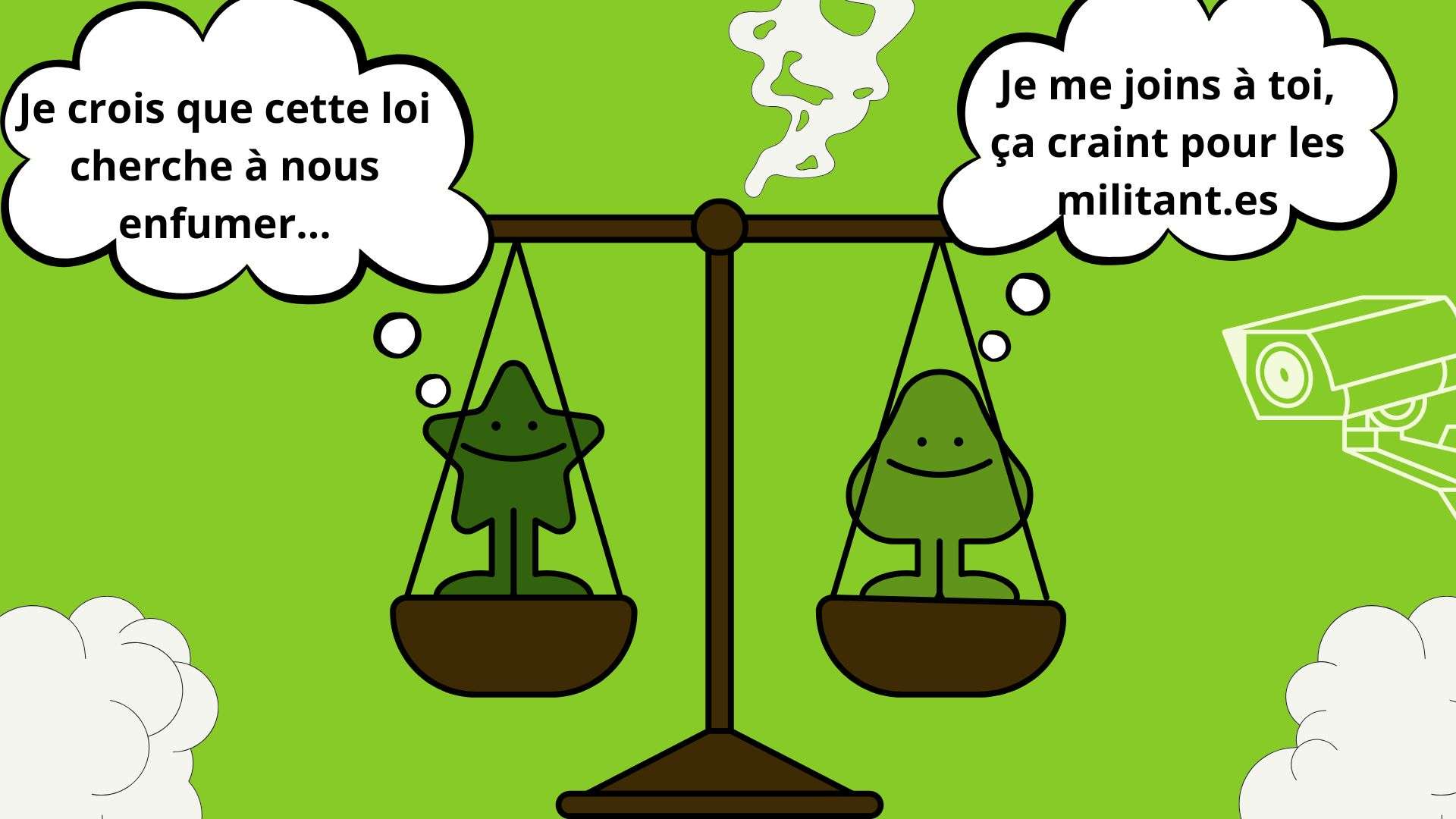Depuis le 17 mars, une loi contre le narcotrafic est en route. Adoptée au Sénat à l’unanimité, avec l’adhésion des socialistes, des écologistes et des communistes, elle est désormais discutée à l’Assemblée nationale.
“Sortir la France du piège du narcotrafic“. C’est ainsi qu’est annoncée cette proposition de loi. Jérôme Durain, élu socialiste et Étienne Blanc, élu les Républicains, en sont à l’origine. Le mois dernier, le Sénat a adopté leur texte à l’unanimité. La proposition est ensuite arrivée à l’Assemblée. Si elle est annoncée comme un moyen de lutter contre le narcotrafic, cette proposition de loi vise en réalité à renforcer lourdement les capacités de surveillance des services de renseignement et de la police judiciaire, avec un texte répressif et liberticide, et cela sur de nombreux points.
Bruno Retailleau définit ce projet comme “un arsenal qui nous permettra, je pense, de faire reculer le narcotrafic dans notre pays“. Pourtant, si l’ambition du projet de loi est de sortir la France du narcotrafic, le texte promet de doper les moyens de la police pour lutter contre les trafiquant·es et s’avère être une dérive sécuritaire, menaçant l’État de droit et les militant·es. En France, les chiffres concernant le trafic de stupéfiants sont affligeants. En 2024, la violence qu’il implique aura fait 110 mort·es et 334 blessé·es. Toutes les villes sans exception sont impactées. Rennes, Lille, ou encore Toulon et Besançon se retrouvent en tête du classement.
Des points problématiques
Cette mesure donnerait de nouveaux moyens de surveillance aux policier·es, comme activer à distance les micros et caméras des appareils connectés de téléphones, ordinateurs ou tablettes. Beaucoup de points dans ce projet de loi questionnent. C’est par exemple le cas de l’article 8. L’article 8 vise à étendre l’utilisation de boîtes noires aux crimes organisés pour le trafic d’armes, de stupéfiants et le blanchiment des produits qui en sont issus. Ces boîtes noires sont des dispositifs utilisés pour la surveillance algorithmique. Elles collectent les données internet ou téléphoniques de tous·tes les Français·es. Ces données se retrouvent ensuite filtrées par des algorithmes : les fameuses boîtes noires.
Bastien Le Querrec, juriste et membre de la Quadrature du Net, expliquait, dans une vidéo livrée au Huffington Post, que ces boîtes noires représentaient une « surveillance de masse ». « On parle d’une atteinte particulièrement disproportionnée, non seulement au droit à la vie privée, mais il y a également un problème en termes de liberté d’expression, puisque quand on se sait surveillé, on modifie son comportement », a-t-il ajouté. Il a aussi expliqué que ces boîtes noires peuvent analyser des métadonnées : qui parle à qui, quelle adresse IP se connecte à tel site… et que ce que rechercheraient ces boîtes noires, c’est un signal faible des connexions et comportements qui seraient suspects.
Le problème étant que ces algorithmes ne vont pas rechercher des personnes en particulier, il s’agit d’une analyse d’un réseau de communication. Toute personne qui utilisera ainsi ce réseau surveillé se retrouvera surveillée, qu’elle soit suspecte ou non. Si ces algorithmes détectent un comportement suspect, les services de renseignement pourront solliciter l’identification de la personne concernée, sous réserve d’une autorisation du Premier ministre. Les données non retenues par ces boîtes noires seront supposées être immédiatement effacées.
L’article 8 prévoit également d’obliger les plateformes de messages cryptés, comme Signal et WhatsApp, à créer volontairement des brèches dans leur sécurité. Cette surveillance ne s’appliquerait donc pas qu’aux dealers mais aussi aux militant·es. Ces messageries, initialement cryptées pour des raisons de sécurité, seraient alors lisibles, compromettant la sécurité de leurs utilisateur·ices.
Les députés à l’origine de cette proposition de loi avaient eux-mêmes, dans leur rapport d’enquête, soulevé que la technique est particulièrement invasive et s’apparente à une surveillance de masse. De plus, le fait qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée sur cette loi et que le dernier rapport du gouvernement sur les algorithmes, paru en 2024, étant classifié, (seul 8 parlementaires y avaient eu accès), suggère que les député·es ont voté une mesure sans en connaître son efficacité.
Laurent Nunez, préfet de Police de Paris, affirme : “Les services de renseignement exercent dans un cadre qui est connu, qui est sous contrôle. Il faut demander une autorisation, ça ne sera possible que, évidemment, pour certains crimes de la criminalité organisée.” Des paroles qui ne suffiront pourtant pas à rassurer celleux qui se souviennent de quelques précédents. Les mesures exceptionnelles anti-terroristes, sont par exemple passées dans le droit commun et utilisées à l’encontre de militant·es écologistes.
Le dossier coffre
L’objectif du dossier coffre est de protéger l’identité des informateur·ices ou des sources secrètes, afin que personne, à l’extérieur de l’enquête, ne découvre leur rôle. Cela permettrait d’éviter que des personnes considérées comme suspectes ne sachent pas, par exemple, qu’une balise a été installée sous leur voiture ou qu’un micro a été placé pour les écouter.
Si des écoutes sont incluses dans le dossier coffre, elles peuvent aussi parfois servir à la défense, pour prouver l’innocence de l’accusé·e. Ces informations sont cruciales pour garantir un procès équitable, car elles permettent à la défense de contester les preuves présentées par l’accusation. Le fait qu’elles soient mises dans un dossier coffre constitue donc une menace. Si les avocat·es sont contre cet article, police et magistrats, eux, veulent qu’il soit maintenu.
Le régime d’isolement carcéral
Introduit par Gérald Darmanin, l’amendement prévoit de placer les gros trafiquant·es dans un isolement quasi complet. Cet isolement prévoit qu’ils n’aient pas accès aux unités de vie familiale, pas de promenades extérieures, des communications limitées et des fouilles systématiques après chaque contact extérieur. Une étanchéité maximale inspirée du modèle anti mafia-italien.
Le but ? Empêcher toute communication entre les personnes incarcérées et l’organisation criminelle. Ce régime pourrait aussi s’appliquer aux personnes en attente de jugement, qui sont donc présumées innocentes. Une présomption d’innocence qui semblait pourtant chère à Laurent Nunez, préfet de police de Paris, favorable à ce projet de loi, lorsqu’il déclarait sur X, à propos de la mort de Nahel en mars dernier : “Je veux rappeler que la présomption d’innocence doit être respectée aussi pour les policiers“. “Ce régime de détention extrêmement strict nous permettra, je l’espère, je le sais, comme en Italie, de pouvoir mettre fin à cette mafia“, a par ailleurs déclaré Gérald Darmanin.
Ce dispositif, discuté aujourd’hui, était celui des anciens quartiers de haute sécurité, supprimé par Robert Badinter en 1982. La raison? Les prisonniers devenaient rapidement fous. Ce texte est donc un texte très sécuritaire, que la Commission nationale consultative des droits de l’homme énonce d’ailleurs comme une remise en question de L’État de droit. Cette proposition de loi contient des éléments qui peuvent porter atteinte à la séparation des pouvoirs. En effet, elle prévoit que le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de l’économie aient des prérogatives qui, normalement sont réservées à l’autorité judiciaire.
Tandis que la droite propose de lutter contre les réseaux par davantage de répression, la gauche, elle, propose de réduire le trafic par la légalisation de cannabis, en faisant un travail de prévention, parallèlement au travail de la police, faisant de la drogue un problème de santé publique.
Salomé Lepretre